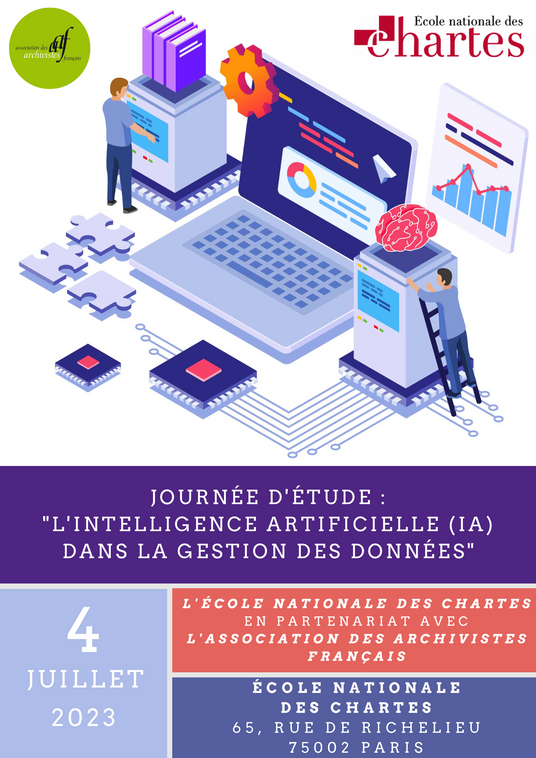
Programme
09h15 – 09h30 : introduction par Eve JULLIEN, vice-présidente au Comité Formation, Emploi et Métiers de l’AAF (COFEM)
09h30-10h : Selma Bensidhoum, Kutay Sefil,
Archives et intelligence artificielle : un état des lieux
Cette intervention a pour objectif de présenter les principaux enjeux relatifs à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine des archives. Nous avons choisi de nous baser sur les principaux piliers du métier d’archiviste et d’explorer les possibilités offertes par cette nouvelle technologie dans chacun de ces domaines : la gestion (collecte, tri, indexation), l’accessibilité, la communication et la protection des documents d’archive, ainsi que leurs exploitations dans le cadre de projets de recherche concrets.
10h-10h45 : Pr. Dr. Basma MAKHLOUF SHABOU,
Projet InterPARES Trust AI : diverses initiatives. Le cas de l’étude sur le développement d’un modèle de maturité pour l’évaluation archivistique à l’ère de l’IA (MAAP_IA)
Dans l’objectif d’échanger sur les changements majeurs susceptibles de varier grandement nos pratiques archivistiques, cette intervention propose un débat structuré en deux parties. Dans un premier temps, le projet InterPARES Trust AI (2021-2026) et l’essentiel de ses diverses initiatives innovantes seront présentés. Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur une initiative en particulier qui s’intéresse au développement d’un modèle de maturité pour l’évaluation archivistique (Maturity Assessment for Appraisal Practices in the AI Age (MAAP_AI, 2023-2025) au sein des institutions. Ce modèle permettra à ces dernières de préciser leur niveau de préparation quant à l’intégration d’outils et de technologies IA. Ce projet s’intéresse aux diverses dimensions stratégiques, juridiques, socio-professionnelles, technologiques, éthiques et écologiques de l’IA une fois appliquées aux processus et dispositifs de l’évaluation archivistique.
11h-11h45 : intervention de Félicien VALLET chef du service intelligence artificielle de la CNIL
IA et protection des données – anticiper et répondre aux enjeux
Cette intervention vise à exposer les enjeux de l’IA pour la protection des données ainsi que les actions de la CNIL en cours et à venir.
Félicien Vallet est chef du service IA à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Il est en charge de la coordination des actions liées à l’Intelligence Artificielle de manière transversale au sein de l’institution. Félicien Vallet est un collaborateur régulier du LINC, le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL. Avant de rejoindre la CNIL, il était chercheur à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et s’intéressait particulièrement aux questions relatives à l’analyse de contenu multimédia et au traitement du signal vocal. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un doctorat en informatique de Télécom Paris (obtenus respectivement en 2007 et 2011).
11h45-12h30 : Loic MAISONNASSE,
IA : Comprendre et saisir les opportunités pour la gestion des données
L’intelligence artificielle (IA) est omniprésente de nos jours, apportant des transformations dans tous les domaines et ouvrant constamment de nouvelles perspectives. Mais qu’est-ce que l’IA réellement ? Ce webinar vous permettra de mieux comprendre les différents mécanismes d’apprentissage sur lesquels repose l’IA et d’appréhender ses domaines d’application. À travers de nombreux exemples concrets, cette présentation vise à faire prendre conscience des capacités de cette technologie et à susciter la réflexion sur les opportunités qu’elle offre.
14h-14h45 : Bénédicte GRAILLES et Touria AÏT EL MEKKI,
De la boîte noire à la boîte à surprise, le programme Pêle-mél et les messageries électroniques
Le programme Pêle-mél, piloté par l’Université d’Angers en collaboration avec la mission des archives du ministère de la Santé et l’École des chartes, a abordé la question des boîtes aux lettres électroniques dans une perspective interdisciplinaire, associant des compétences en intelligence artificielle et en archivistique pour tester des stratégies d’exploration de corpus de courriers électroniques afin d’en favoriser l’évaluation et l’exploitation. Il s’agit d’aider l’archiviste à interpréter et à contextualiser une ou des boîtes aux lettres via l’extraction d’entités nommées, de termes, la classification de termes et de messages, en mobilisant un certain nombre d’outils et de techniques de traitement du langage naturel. La méthode est basée sur l’apprentissage automatique supervisé et utilise des modèles de réseaux neuronaux. Le programme a développé deux prototypes, l’un pour classifier, l’autre pour interroger les métadonnées et explorer le contenu. Bien que l’expérimentation concerne un domaine spécifique – le ministère de la santé – les résultats sont généralisables à d’autres environnements. Ce programme a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, dans le cadre de l’appel à projets Services numériques innovants.
14h45-15h30 : Jean-François MOUFFLET,
L’intelligence artificielle au service de la description et de la diffusion des archives. Retour sur des projets conduits dans le réseau des services d’archives publics.
C’est à partir de 2015 que l’intelligence artificielle a commencé à être véritablement utilisée pour traiter des fonds d’archives. Notamment, deux technologies, la reconnaissance des écritures manuscrites (ou HTR) et la reconnaissance d’entités nommées (NER), contribuent à renouveler profondément le traitement des archives, mais aussi leurs modalités de consultation et d’usage. Différents projets conduits dans les services permettent de mettre en évidence des finalités variées, qui profitent aussi bien aux usagers des archives qu’aux archivistes eux-mêmes. Si les chercheurs se réjouissent des moteurs de recherche qui les aident à retrouver instantanément, dans le texte même de la source, les termes qui les intéressent, les archivistes peuvent quant à eux enrichir les descriptions archivistiques, en réutilisant du texte transcrit dans leurs inventaires, ou en indexant avec une plus grande facilité des entités qu’ils pourront ensuite lier à des référentiels. L’intelligence artificielle permet ainsi à la fois de remettre les archives au cœur même de la recherche historique et de mieux sémantiser leurs données d’identification.
15h45-16h30 : Éléonore Alquier,
L’intelligence artificielle, enjeux et opportunité pour le patrimoine audiovisuel : retour d’expérience de l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
Cette intervention abordera la manière dont l’Ina s’approprie progressivement les technologies d’intelligence artificielle au fur et à mesure de leur arrivée à maturité, pour les intégrer dans différentes étapes de la chaîne de traitement archivistique :
en production documentaire, en soutien à la réalisation de tâches fastidieuses voire impossible à effectuer humainement ;
en aval du traitement, pour créer des clés d’analyse sur des corpus constitués à la demande ;
ou encore pour générer des indicateurs analytiques du discours médiatique.
Cette présentation s’interrogera sur les enjeux d’organisation, d’évolution des compétences et d’accompagnement au changement soulevées par le recours à ces technologies.
16h30-17h30 : table-ronde « Formations et intelligence artificielle » avec Francesco SIRI, Emmanuelle BERMES et Éve JULLIEN (vice-présidente au comité formations, emplois, métiers de l’AAF)
17h30-17h45 : conclusion par Edouard Vasseur